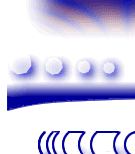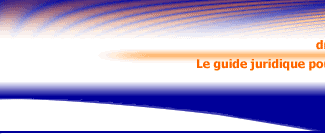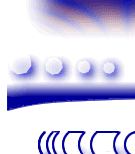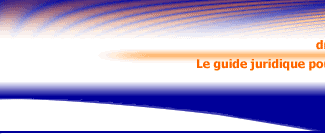| Une décision
du TGI de Strasbourg du 3 février 1998 concernant
la reprise d’articles des Dernières nouvelles
d’Alsace ainsi que des émissions télévisées
de France 3 sur Internet considère que seuls les
droits de la première publication sont cédés
par les journalistes à leur employeur, « toute
autre publication nécessitant une cession de droits
».
Cette décision contient même cette déclaration
d’intention : « Les droits d’auteur doivent
être protégés sur les réseaux
numériques ».
Un accord est intervenu entre les syndicats de journalistes
et la société éditrice des DNA sur
la cession des droits d’auteur des journalistes pour
la diffusion par voie électronique ou informatique
du journal avant que l’arrêt de la Cour d’Appel
de Colmar ne soit rendu (15/09/1998). Cette action a donc
eu le mérite de poser la question des droits d’auteur
et d’aboutir à un arrangement entre les parties.
La Cour d’Appel a elle sanctionné France 3
jusqu’à la conclusion d’un accord similaire
avec ses journalistes.
Le Figaro a également du affronter les syndicats
de journalistes dans le cadre de la mise en ligne d’archives
du journal depuis 2 ans par voie télématique
avec possibilité d’obtenir une copie par télécopie
ou e-mail :
Dans un jugement du 14 avril 1999, le TGI de Paris considère
« qu’en l’absence de convention expresse
contraire, la rémunération versée au
journaliste n’emporte qu’un droit de reproduction
épuisé dès la première publication
sous la forme convenue entre les parties » et que
toute publication supplémentaire des articles, «
notamment par voie télématique litigieuse,
est constitutive de contrefaçon ouvrant droit à
l’allocation d’indemnités ».
En appel, la CA de Paris confirme la décision en
étendant son champ d’application à «
l’exploitation des dits articles sur Internet, s’agissant
là encore, d’un mode d’exploitation non
prévu lors de la conclusion des contrats, et en conséquence
non visé par ceux-ci ».
Comme dans les affaires des Dernières Nouvelles d’Alsace
et du Figaro, le journal Le Progrès, a été
condamné en juillet 2000 par le TGI de Lyon, à
régler un supplément d’indemnité
aux journalistes car le quotidien avait diffusé sur
Minitel et Internet des articles déjà édités
sur papier, et ce sans avoir négocié une nouvelle
cession de droits avec les journalistes.
Toutes ces décisions ont refusé de considérer
un journal comme une œuvre
collective (ce qui permettrait de transférer
les droits patrimoniaux à l’employeur) en considérant
par exemple que « les articles des journalistes sont
parfaitement identifiables ( …) et ne se fondent pas
dans l’ensemble désigné comme étant
le journal Le Progrès ».
Un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 décembre
1999 a condamné le quotidien "Le Progrès"
pour violation des droits d'auteurs des journalistes sur
Internet. Selon les juges, la société éditrice
est donc bien investie des droits sur l'ensemble. Mais l'arrêt
précise que cette situation ne doit pas porter préjudice
aux droits que possède chacun des journalistes sur
sa propre contribution.
Le syndicat de la presse quotidienne régionale et
quatre syndicats de journalistes ont conclu, lundi 8 novembre
1999, un accord sur les droits d'auteurs des journalistes
applicables à Internet. Le document définit
leurs droits lorsque leurs articles sont exploités
sur Internet, et prévoit les conditions de réutilisations
de leurs papiers et de leurs photos, non seulement sur papier,
mais aussi sur Minitel, sur Cédérom, et sur
le Net.
Le TGI de Strasbourg condamnera une nouvelle fois France
3 pour l’utilisation de journaux en images sur le
Net (16/11/2001).
Sur ces bases jurisprudentielles, un journaliste a fait
condamner à 6000 euros de dommages et intérêts
la SA Publi News qui avait publié 29 de ses articles
sans son autorisation. Le TGI de Paris (19/02/2002) considère
qu’ « il est constant que le fait par l’éditeur
de publier dans un journal électronique des articles
publiés initialement sous forme papier sans autorisation
spécifique de leur auteur constitue une atteinte
au droit de reproduction leur appartenant ».
Cela résume la position des tribunaux français
face à la diffusion d’articles en ligne : il
s’agit d’une nouvelle reproduction qui ouvre
le droit à une nouvelle rémunération. |