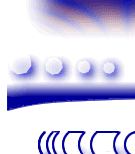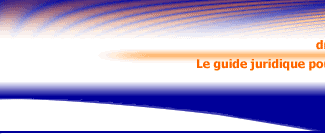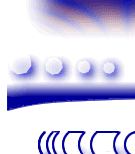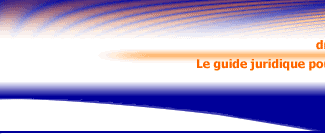1. Les décisions françaises
Tribunal
de commerce de Nanterre, référé, 8
Novembre 2000 (1), affaire
Stepstone / Ofir France,
Les sites Ofir
contenaient des annonces provenant du site de Stepstone
sous forme de listes contenant des liens hypertextes sur
le site www.stepstone.fr pour y recueillir les informations
complètes.
Le tribunal énonce
un principe intéressant pour la jurisprudence à
venir sur les liens hypertextes :
« la raison d’être d’Internet
et ses principes de fonctionnement impliquent nécessairement
que des liens hypertextes et intersites puissent être
effectués librement, surtout lorsqu’ils ne
se font pas, comme en l’espèce, directement
sur les pages individuelles du site référencé
».
Les termes employés
par le Tribunal montrent une réelle volonté
d'élever ce principe au rang d'usage.
Tribunal
de commerce de Paris, référé, 26 décembre
2000, affaire Cadres on line / Keljob (2)
Le moteur de
recherche Keljob.com permettait l’accès aux
pages de Cadresonline.com par le biais de liens profonds,
donc sans passer par la page d’accueil du site. De
plus les liens en question modifiaient les URL des pages
visitées et ne faisaient pas mention du site cible,
de sorte que l’internaute ne pouvait se rendre compte
de la source de l’information obtenue.
Il est vrai qu’aucun
texte ne prévoit encore la nécessité
d’une autorisation, que ce soit au niveau national
ou au niveau européen. Cependant le tribunal considère
que cette action comme la représentation d’une
œuvre sans le consentement de son auteur, ce que condamne
l’article L 122-4 du CPI.
Le magistrat
a considéré que « s’il est
admis que l’établissement de liens hypertextes
simples est censé avoir été implicitement
autorisé par tout opérateur de sites web,
il n’en va pas de même pour ce qui concerne
les liens dits « profonds » et qui renvoient
directement aux pages secondaires d’un site cible,
sans passer par sa page d’accueil ».
Mais on ne peut
ici procéder à aucune généralisation
d’autorisation ou d’interdiction pour les liens
hypertextes à partir de cette décision d’espèce.
De plus, il faut
rester prudent sur la typologie liens profonds / liens simples
adoptée pour l’instant par les juges français.
En effet, le principe selon lequel un lien simple est présumé
avoir été autorisé par l’éditeur
pourrait être dépassé par l’élément
intentionnel, par exemple pour un lien vers un contenu diffamatoire
|